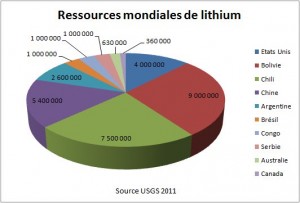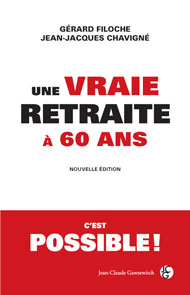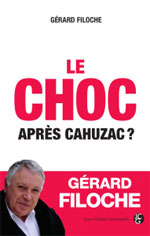Bolivie pays martyr
face a la division de la gauche et du possible retour de la droite en Bolivie en 2025
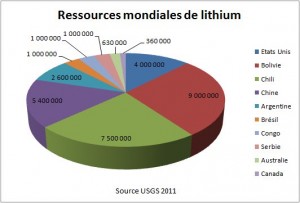
Jamais, dans sa carrière de journaliste, Tom Phillips n’avait vécu cela. Arrivé à El Alto, près de La Paz, le lendemain du massacre devant la raffinerie de Senkata, le correspondant du Guardian en Amérique latine a été accueilli par les applaudissements d’une haie d’honneur. L’image circule sur les réseaux sociaux. Elle cloue au pilori les grands médias.
Deux jours après le coup d’État, le nouveau ministre du Gouvernement, Arturo Murillo, et sa ministre des Communications annonçaient que les journalistes « séditieux » seraient arrêtés, leur nom publié. Le jour même, tous les journalistes et techniciens argentins étaient agressés par les comités civiques de Santa Cruz, les milices fascistes. Ils étaient contraints de se regrouper, puis de se réfugier à l’hôtel, avant d’être exfiltrés par leur ambassade.
Telesur a pu émettre pendant quelques jours, ses reporters sur le terrain (Marco Teruggi et Willy Morales) multipliant les précautions, parlant de « gouvernement de facto », tandis que, dans les studios, le présentateur évoquait clairement « le coup d’État ». La chaîne a informé sur les massacres à Cochabamba puis à Senkata. Après les derniers reportages, celui à l’hôpital d’El Alto, où l’on entend des cris de douleur, où l’on voit des cadavres, où un médecin désespéré, Aiver Guarana, arrêté depuis, pleure devant la caméra, les transmissions ont été coupées.
À Senkata, en direct de la tuerie, un journaliste latino-américain se désolait : « Nous sommes deux. Où est la presse internationale ? » Il filmait le massacre. Depuis, il se cache parmi la population d’El Alto.
De nouveaux « journalistes » sont apparus. Ils portent des masques et des casques estampillés « prensa ». Sur une vidéo, ils agressent un étudiant en cinéma et documentaire, qui leur lance : « Je fais le travail que la presse ne fait pas ! » Les prétendus « journalistes » le désignent aux policiers, qui l’arrêtent aussitôt.
Les médias français et européens sont absents. Un rideau de fer médiatique s’est abattu sur le pays. La Fédération internationale des journalistes, le SNJ et le SNJ-CGT ont eu beau dénoncer le coup d’État, silence !
À l’exception de l’Humanité, la presse censure la tragédie : pas un mot ou presque sur la maire indigène enduite de peinture rouge et tondue, pas un mot sur les paysans conduits au bord d’une lagune, forcés de s’agenouiller puis emmenés vers une destination inconnue, pas un mot ou presque sur l’incendie et le pillage des maisons d’Evo Morales, de sa sœur, des élus et responsables du Mouvement vers le socialisme (MAS), le parti politique du président, pas un mot ou presque sur la répression des manifestants, partis jeudi d’El Alto avec leurs martyrs dont les cercueils ont été abandonnés dans les rues, sous les tirs.
Les riches blancs donnent libre cours au racisme et à leur soif de vengeance : ils ne supportaient pas qu’un Indien, un Aymara, nationalise les richesses du pays pour créer des écoles et des universités, rendre la santé gratuite, donner des pensions de retraite, réduire de moitié la pauvreté, le chômage et l’analphabétisme. Et donne à la majorité du pays, les « peuples premiers », leur place dans la société et au pouvoir. À commencer par leur drapeau, le Wiphala, dont le nom signifie la victoire qui ondoie, qui était le second drapeau du pays. Du jamais-vu.
Français et Européens, vous ne saurez rien de la tragédie. Éditorialistes et « experts » patentés sont de sortie. Au mieux, vous aurez un débat : c’est un coup d’État ou de la barbe à papa ?
La vérité, obstinée et sanglante, fait son chemin. Ce coup d’État a suivi le scénario du Golpe Blando (Lawfare), élaboré par Gene Sharp, théoricien de la CIA.
La vérité ? Les accusations de fraude aux élections sont un montage de la droite et de la CIA.
La vérité ? L’Organisation des États américains (OEA), « ministère des Colonies » financé à 60 % par les États-Unis, a joué le rôle déclencheur du coup d’État. Deux centres d’études, dont le Center For Economic And Policy Research de Washington, ont critiqué le rapport de l’OEA, affirmant que, même si les votes contestés étaient reportés sur la liste de l’opposition, Evo Morales arrivait largement en tête.
La censure prolonge l’implication de l’Union européenne et de la France. Le Parlement européen a refusé d’inscrire le terme de « coup d’État » à l’ordre du jour du débat sur la situation en Bolivie. Federica Mogherini, responsable de la politique étrangère de l’UE a reconnu le putsch en arguant de la nécessité d’éviter « le vide du pouvoir ».
Depuis, le représentant de l’UE, Léon de la Torre se trouve au chevet de la dictature. André Chassaigne, député communiste, a adressé une question écrite au gouvernement, lui demandant si les interventions de l’UE et de la France ont pour but de « participer et aider au rétablissement d’un État de droit ou de faire pression sur les élus majoritaires pour qu’ils se soumettent ». Il lui réclame « d’informer immédiatement la représentation nationale sur le sens réel, le contenu et les démarches effectuées par la France et l’Union européenne en Bolivie ».
Quant à l’administration Trump, organisatrice en coulisse du coup d’État, elle laisse ses complices faire le sale boulot.
Dénigrés et menacés, les députés et sénateurs du MAS, majoritaires à 70 % à l’Assemblée plurinationale, ont voté pour de nouvelles élections que l’UE, compromise dans la reconnaissance du coup d’État, était pressée de pouvoir annoncer. Quelles garanties alors que l’armée ratisse les campagnes pour y semer la terreur ? Que les arrestations et les disparitions se multiplient ?
L’intervention de la porte-parole MAS de l’Assemblée, Sonia Brito, dont la gestuelle traduit la véhémence, a été censurée sur Twitter. Au Sénat, sa collègue, dans une déclaration alambiquée et précipitée, souligne : « Des médias annoncent que le groupe radical aurait pacté avec l’opposition. C’est faux. Cela n’est pas un pacte… Je ne vais pas contredire la couverture du gouvernement de transition. (…) Je ne pense pas qu’un gouvernement de transition expulse ses concitoyens, cause 32 morts, plus de 780 blessés, arrête plus de 1 000 personnes, accuse les journalistes de sédition. »
Les putschistes menaçaient de promulguer, lundi, un décret pour annoncer le nouveau scrutin, si le Parlement n’acceptait pas leurs conditions.
Quelles conditions ? Il suffit de voir le cabinet fantoche faisant le signe du WP (White Power) de la « suprématie blanche » lors de leur prestation de « serment » pour comprendre son objectif : installer durablement un régime raciste et fasciste.
« Si nous laissons passer ce qui se passe en Bolivie, cela risque de se passer partout », a déclaré José Luis Zapatero, l’ex-président du gouvernement espagnol. L’avertissement rappelle celui lancé par les antifascistes, les artistes et intellectuels des années 1930. Le voile noir médiatique, le silence des élites, le rôle de l’UE nous préparent des lendemains cauchemardesques, car c’est de nous qu’il s’agit aussi. La bête immonde est de retour. L’histoire enseigne qu’il est impossible de l’apprivoiser.
Maïté PINERO
Bolivie, la bête immonde est de retour – un coup d’état occulté dans les médias.
* Bolivie > Bolivie, Notre Victoire, par Graciela (…)
* Bolivie > Une, deux, trois Bolivie… La déferlante Evo (…)
* Bolivie > Elections en Bolivie : « Le peuple (…)
* Bolivie > Elections 18 décembre : Evo Morales peut-il (…)
* Bolivie > Bolivie, élections du 18 décembre : entre (…)
* Bolivie > Bolivie, 18 décembre : Evo Morales premier (…)
* Amériques > Interview d’un compagnon du Che : (…)
> Bolivie
GUERRE SOCIALE, SOUVERAINETE NATIONALE ET REVOLUTION
Année 2000
Les paysans s’insurgent contre le prix de l’eau (débuts de la « guerre de l’eau »). Les mouvements de protestation se multiplient contre le prix de l’eau, le chômage et les difficultés économiques. Le gouvernement du président Hugo Banzer décrète l’état de siège pour trois mois.
Avril 2002
L’insurrection de Cochabamba expulse la transnationale californienne Bechtel, qui était en charge des réseaux d’eau potable et d’assainissement de la 3e ville du pays.
Février 2003
Trois jours d’explosion populaire obligent le président Gonzalo Sanchez de Lozada à renoncer au projet fiscal d’imposition des salaires des fonctionnaires qu’exige le FMI. L’ « Impuestazo » fait au moins 30 morts.
Septembre-octobre 2003
Ce qu’on a appelé la « guerre du gaz », un mois d’insurrection populaire, chasse le président Gonzalo Sanchez de Lozada, qui s’enfuit à Miami. Au moins 80 morts. Son vice-président, Carlos Mesa, assume la présidence. Il cherche aussitôt à temporiser, afin de désamorcer le mouvement social et de le diviser. Le Mouvement vers le Socialisme (MAS) d’Evo Morales lui apporte un soutien critique.
Le mouvement de sécession
Depuis novembre 2003 l’oligarchie réactionnaire des patrons et propriétaires terriens de Santa Cruz (2e ville du pays et province la plus riche) provoque des mobilisations pour l’autonomie des provinces de l’Est, qui détiennent les ressources pétrolières. Les temps-forts de cette agitation sont les journées des 25 juin 2004, 11 novembre 2004 et 10 janvier 2005, au cours desquelles l’oligarchie proclame la sécession, comme réponse au mouvement social ouvrier et paysan de récupération nationale des richesses du sous-sol et de lutte contre la grande propriété foncière. La province de Santa Cruz, centre économique du pays, avec 2,3 millions d’habitants, possède avec celle voisine de Tarija, plus de 85% des réserves de gaz et de pétrole du pays.
Le référendum de juillet 2004
Le 10 juillet a lieu le référendum sur les hydrocarbures. Celui-ci est boycotté par une partie des mouvements sociaux. Néanmoins ceux qui votent se prononcent à 86,4% pour la réforme de la loi et à 92,2% pour la récupération par l’Etat de la propriété des hydrocarbures à la sortie des puits, ce qui devrait se traduire par l’expropriation des transnationales. Pour les radicaux, ce référendum n’a été qu’une mascarade.
Janvier 2005
Les 10 et 11 janvier une nouvelle flambée sociale secoue le pays. L’ensemble du mouvement social manifeste contre la hausse du prix du gaz imposée par le FMI (« gazolinazo »). A Santa Cruz, l’opposition patronale au « gazolinazo » se traduit par une déclaration sécessionniste (proclamation d’autonomie du 28 janvier), alors que la population d’El Alto La Paz expulse la transnationale française Suez-Lyonnaise des Eaux qui gère l’eau potable de la grande cité populaire rebelle (1 millions d’habitants) située sur les hauteurs de la Paz.
Mars 2005
Mesa louvoie. Il fait voter une loi sur les hydrocarbures qui ne change rien (18% de royalties sur les recettes incontrôlables des transnationales). Il feint de démissionner, afin de désactiver le mouvement social et d’unir la réaction (constitution d’un « Pacte National entre les partis patronaux).
Le 9 mars les organisations COB, FEJUVE (Fédération des assemblées de quartiers), CSUTCB (paysans indigénistes menés par Felipe Quispe), MAS (leader : Evo Morales), etc., forment de leur côté un « Front Unique ».
Le 18 mars une nouvelle loi sur les hydrocarbures est votée au parlement, un peu moins favorable aux transnationales (taxation supplémentaire) mais qui ne change rien sur l’essentiel, à savoir qu’elle ne touche pas à la propriété des ressources. Le texte doit encore être soumis au Sénat.
Alors que certains souhaitent des élections anticipées, comme Mesa lui-même l’a proposé (selon le calendrier électoral les présidentielles et législatives sont pour 2007), que d’autres et parfois les mêmes pensent résoudre la crise politique et de gouvernabilité par une Constituante, il ne fait pas de doute que de nouveaux affrontements sont inévitables. Pour quelle issue ? Les deux camps fourbissent leurs armes.
Mai 2005
Le 5 mai, le vote par le Congrès de la nouvelle loi sur les hydrocarbures relance la mobilisation sociale.
Le 9 mai, Evo Morales, qui se trouvait à Cuba (où il a été opéré du genou le 21 avril), rentre en Bolivie.
Le 10 mai, Mesa refuse de signer la nouvelle loi qui améliore la part du pays sur les dividendes énergétiques (sur la base de 18% de regalias, qui portent sur la valeur du gaz à la sortie des puits, et 32% d’impôt sur les profits des compagnies).
Au sein du mouvement social, 2 positions se dégagent :
Celle autour du MAS, qui ne réclame pas la nationalisation, mais « 50% de royalties sur le gaz extrait ».
Celle des habitants d’El Alto, avec la Fejuve, de la COB et des paysans andins de la CSUTCB, exige la (re)-nationalisation des hydrocarbures avec des mots d’ordre tels que « démission de Mesa », « fermeture du Parlement », « ouvriers et paysans au pouvoir », « peuple au pouvoir ». Ces mots d’ordre s’entendent dans les rues de La Paz à longueur de journées dans la bouche des enseignants, mineurs, étudiants, chômeurs et paysans qui manifestent et font le siège des bâtiments gouvernementaux.
Le dirigeant de la COB Jaime Solares appelle Evo Morales à « respecter le pacte d’unité signé, lequel vise la nationalisation ».
Le 25 mai, un groupe de jeunes militaires (menés par 2 lieutenants-colonels) appelle à l’unité civico-militaire pour la nationalisation du gaz et du pétrole, la fermeture du Congrès et le départ de Mesa. Evo Morales exprime son désaccord sur cette démarche. Jaime Solares, pour sa part, déclare : « Dire que si surgit un Chavez, je le soutiendrais, ce n’est armer aucun coup d’Etat ».
Après 2 semaines de luttes massives intenses, le mouvement s’accorde une petite trêve le 26 mai, jour férié de la Fête-Dieu. Mais le lendemain, les barrages reprennent..
QUELLE ISSUE ?
L’analyste politique Alvaro Garcia Linera dresse le constat suivant : « Pour les mouvements sociaux se pose à nouveau la question du pouvoir, mais dans la voie électorale comme dans la voie insurrectionnelle, qui sont les uniques méthodes à leur disposition, ils sont faibles, d’où l’impasse actuelle ». Dès lors, estime t-il, la seule possibilité d’articulation passe par l’Assemblée Constituante (Pagina/12, 24-05-05). C’est aussi la thèse soutenue par Evo Morales.
La position du Parti Communiste de Bolivie est différente (communiqué du 26-05-05). A son sens, les forces du camp populaire ne sont pas prêtes pour la prise immédiate du pouvoir, et il met en garde contre les actions aventureuses qui ne feraient que le jeu de la droite et de l’impérialisme. Le PCB affirme que la division est organisée de l’étranger et que des agents de l’impérialisme sont infiltrés dans le mouvement ouvrier et populaire. La seule voie raisonnable est, dans la situation actuelle, d’exiger des élections générales et l’union des forces dans un vaste bloc patriotique, populaire, anti-oligarchique et anti-impérialiste.
Pour l’extrême gauche, la situation est toute autre. Les élections comme l’Assemblée Constituante sont des pièges destinés à sauver les classes dominantes et les intérêts de l’impérialisme. Les travailleurs doivent se donner pour tâche la conquête du pouvoir politique et du pouvoir économique et constituer leur gouvernement à eux d’ouvriers et de paysans. Pour expulser les transnationales, la seule manière est l’action directe des travailleurs, la voie insurrectionnelle.
R.B
L’ancienne cité d’argent et l’enfer de ses mineur
Par Irene Caselli, il manifesto.
Alberto a 29 ans et se plaint de son travail : les conditions sont précaires, l’espace réduit et la compagnie rare. « Ça ne me plaît pas » dit-il, « mais quelles sont les alternatives ? ». Nous sommes à 100 mètres sous terre, dans une cavité d’un mètre cinquante de haut. Rolando passe des journées entières seul, accroupi, creusant des trous de 30-50 cm dans la roche, sans autre outil qu’un scalpel. Il travaille depuis l’âge de 16 ans dans une des mines de Potosi, en Bolivie, et c’est l’un des plus chanceux : la plupart de ses collègues résistent au maximum dix ans avant de succomber à la silicose, la maladie pulmonaire due à l’inhalation des poussières minérales.
Potosi est un nom que seuls les passionnés de l’Amérique latine connaissent désormais chez nous. Pourtant l’histoire de l’Occident est étroitement liée à cette petite ville bolivienne qui fut en son temps la plus riche des Amériques. Quand on parcourt ses ruelles étroites et pentues, le contraste saute aux yeux, entre la population, en majorité indigène et parmi les plus pauvres du continent, et l’architecture coloniale raffinée, qui a valu à la ville le titre de patrimoine culturel de l’humanité, de l’Unesco. L’explication sur la splendeur et la décadence de Potosi se trouve dans les viscères de son Cerro Rico (littéralement montagne riche) qui autrefois était plein d’un argent pur et maintenant est un géant vide, dont on dit qu’il déborde du sang et de la sueur des milliers de mineurs qui y ont perdu la vie.
Le premier fut Huallpa
L’argent fut découvert en 1545 par l’indigène Huallpa, qui s’était perdu dans la montagne en poursuivant un lama. Quelques années plus tôt déjà, le roi inca Huayna Capac avait entendu parler de la richesse du cerro et avait donné l’ordre de creuser. Mais ses serviteurs, après avoir commencé les travaux, entendirent des voix menaçantes, en quechua, qui leur ordonnaient de partir. Epouvantés, ils s’enfuirent tous et changèrent le nom de la montagne : de Sumaj Orcko (« belle montagne ») à Potojsi’, qui signifie « tonne, explose ».
Les espagnols ne se laissèrent pas intimider par les malédictions ; ils recrutaient chaque année 12.000 indigènes pour les faire travailler dans les mines d’argent. En 1573, la cité comptait déjà 120.000 habitants, autant que Londres et plus que Séville, Madrid, Paris ou Rome. En 1650, avec 160.000 habitants, Potosi était une des plus grandes villes du monde. L’empereur Charles Quint de Habsbourg donna à la ville le titre de villa imperial et un emblème qui disait : « Je suis le riche Potosi, je suis le trésor du monde, je suis le roi des montagnes et l’envie des rois ». Les fêtes, à la gloire de la couronne espagnole, duraient des mois entiers, alors que des dizaines d’églises et de palais étaient édifiés, ornés de matériaux précieux provenant du monde entier.
En 1605, Cervantès fait dire à son Don Quichotte « ça vaut un potosi » pour indiquer quelque chose de très grande valeur ; l’expression « c’est le Pérou » était déjà passée de mode. Des écrivains boliviens affirment qu’avec l’argent extrait du Cerro Rico pendant trois siècles, les espagnols auraient pu construire un pont reliant Potosi au palais royal de Madrid. Un tableau du 18ème siècle, « La Virgen del Cero », exposé maintenant à la casa de la Moneda (le troisième Hôtel de la Monnaie des Amériques, après Mexico et Lima), représente le monde aux pieds du Cerro Rico, symbolisant à quel point Potosi a été la base économique aussi bien de l’Amérique que de l’Europe.
A l’époque de l’administration espagnole, 80 esclaves mouraient chaque jour dans l’extraction de l’argent : ceux qui résistaient au voyage jusqu’à Potosi depuis les provinces voisines, ou aux accidents dans la mine, étaient décimés par la pneumonie à cause du choc thermique entre l’intérieur et l’extérieur de la montagne. Potosi est la ville la plus haute du monde : le Cerro Rico se trouve à 4 000 mètres au dessus du niveau de la mer et le froid y est constant, été comme hiver.
« Seulement 20 morts »
« Les conditions sont meilleures, maintenant, et les accidents moins fréquents. Vingt personnes seulement sont mortes en 2004. Mais les mineurs qui travaillent dans les zones les plus dures meurent lentement », dit Rolando Colque Rios, le guide. La mine Candelaria Baja appartient à une coopérative et les mineurs gèrent tout, seuls. Le travail est flexible : on gagne normalement entre 500 et 600 bolivianos par mois (respectivement 58 et 68 euros) mais si une famille a besoin de plus d’argent, on peut travailler jusqu’à 24 heures par jour et avoir un salaire plus haut. On fait tous les travaux, par roulement, et les plus durs sont affectés aux jeunes, qui ont plus d’énergie. Les plus petits ont huit ans.
Alberto me dit qu’il ne s’ennuie pas à travailler seul toute la journée. Il dit qu’il change souvent et n’a pas de préférence. Entre la poussière, les minerais et les explosions de dynamite, on respire avec peine. Pendant que je lutte contre une crise d’asthme, il me demande : « Et toi, ça te plaît, la mine ? ».
Les mineurs s’habituent déjà à nous, les gringos, qui payons pour voir comment ils gagnent leur vie. Rolando nous explique que ça a été dur de se faire accepter. « Surtout au début, ils nous appelaient gringueros, avec mépris, et ils ne venaient pas nous parler. Mais maintenant ils sont en train de comprendre l’importance du tourisme dans la région », nous dit-il. Rolando a 34 ans et il a travaillé dans une de ces mines, mais ensuite il est arrivé à faire des études de tourisme et maintenant ça fait dix ans qu’il travaille comme guide.
« Moi, je veux faire quelque chose pour les miens, pour faire connaître la Bolivie, pour faire connaître notre culture aux étrangers », me dit-il. Sa compagnie, Koala Tours (www.koalatoursbolivia.com) donne maintenant 15 % de son revenu à la coopérative et s’assure que tous les touristes ont un cadeau pour les mineros quand ils arrivent.
Dynamite au marché
Le tour, après une halte pour prendre l’équipement nécessaire, casque et lanterne compris, amène les touristes au marché des mineurs, où on peut acheter tout ce dont on peut avoir besoin sous terre : dynamite, mèches, (Rolando plaisante et dit qu’il peut nous faire une leçon de terrorisme), cigarettes, feuilles de coca, limonades.
Sous terre on ne mange pas, parce que la nourriture ne tient pas. Les mineurs passent des journées entières en mastiquant des feuilles de coca, qui éliminent la fatigue et la faim, et stimulent l’énergie. Un groupe, qui arrive sur un des chariots servant à ramasser le minerai creusé, se bat pour une bouteille de limonade. « Il faudra en porter plus la prochaine fois », dit Rolando
« L’important dans la mine c’est de rester de bonne humeur, de rire et de plaisanter. Pas vrai, Miguel ? », dit Rolando, en se tournant vers un des plus vieux, qui vient d’avoir cinquante ans.
Entre l’obscurité et la fatigue, il est difficile de percevoir l’âge des visages. Les mineros ont un rituel, qui s’appelle challa : ils boivent une eau de vie à 96 degrés pour gagner les faveurs de la pacha mama, la mère terre, et avant de l’avaler ils en offrent quelques gouttes au sol. Dans la période après le carnaval, certaines parois de la mine sont décorées de petits drapeaux colorés.
Dee ces tonnes de matériau sorties à la main et transportées péniblement, on extrait maintenant surtout de l’étain – dont la Bolivie est le pus grand exportateur du monde- du zinc et de la poudre d’argent. Mais seulement 60% du raffinage est effectué sur place ; le reste se fait dans des usines modernes, en Europe, parce qu’il n’y a pas, ici, les fonds nécessaires, seulement la main d’œuvre spécialisée.
L’éducation, dit Rolando, est la clé pour résoudre les problèmes du pays, où il y a encore 13% d’analphabétisme. « Ici, beaucoup essaient de faire le sacrifice et d’aller aux cours du soir pour finir leurs études. Mais ils sont complètement épuisés après la journée de travail. D’autres abandonnent l’école. Dans les mines, il y a 2000 enfants qui n’y sont jamais allé »
Une phrase de José Marti
Sur un des murs de la ville, il y a un murales avec une phrase du révolutionnaire cubain José Marti qui dit : « L’éducation est le seul moyen de sortir de l’esclavage ». Pour beaucoup le pays est encore esclave, aux mains des multinationales étrangères. En octobre 2003, Gonzalo Sanchez de Lozada, le président pro étasunien et néolibéral, favorable aux privatisations sauvages, fut obligé de s’enfuir après des semaines de grandes manifestations populaires. Son successeur, l’actuel chef de l’état Carlos Mesa, avait promis, entre autres choses, de promulguer une loi sur les hydrocarbures, qui augmente les taxes des compagnies étrangères pour l’extraction du gaz naturel, dont la Bolivie est un grand producteur. Mais Mesa continue à décevoir, et la mobilisation populaire grandit. En janvier dernier, les protestations ont entraîné l’expulsion d’une énième multinationale hors du sol bolivien, la compagnie française Suez Lyonnaise des Eaux, qui administrait le service des eaux et le réseau des égouts à La Paz.
Un article de fond du journal El Potosi, le lendemain de ma visite à la mine, dit que les politiques devraient davantage écouter les gens, surtout les indigènes, sinon le pays se retrouverait dans la même situation qu’en 2003, quand une centaine de personnes mourut dans les affrontements avec la police.
Rolando a les idées claires : il faut plus de fonds pour l’éducation et plus d’investissements en infrastructures, et tout doit être en main des boliviens, qui ont déjà trop bradé leur pays. « Je veux simplement voir le développement de cette région et de notre pays, des infrastructures », dit Rolando avec son accent quechua. « Un aéroport serait déjà un grand pas en avant pour le tourisme. Nous voulons le mieux pour notre peuple, nous voulons que les choses fonctionnent ».
Irene Caselli
Bolivie, Notre Victoire, par Graciela Ramírez.
22 décembre 2005
… »Ahora queda luchar por la Unión de Latinoamérica, reconstruir el Tahuantinsuyo la Patria grande de Bolvar para vivir bien« . [1
..." Maintenant il nous reste à nous battre pour l’Union de l’Amérique Latine, reconstruire le Tahuantinsuyo [2] ou la grande Patrie de Bolivar pour vivre bien.« .
Evo Morales a gagné par K.O. Il a dépassé les 51% des votes malgré la campagne méprisable de la droite, malgré les médias et la CNN qui ont fait appel à la peur, aux sentiments réactionnaires et au mensonge. Malgré l’épuration des listes des électeurs qui a empêché des centaines de milliers de Boliviens d’exercer leur droit légitime d’exprimer leur volonté souveraine. Malgré la haine ancestrale de l’oligarchie et des grands monopoles, le Mouvement pour le Socialisme (MAS) dirigé par Evo Morales a obtenu une victoire complète lors des élections qui ont eu lieu ce dernier dimanche dans le pays andin.
Cela n’était pas prévisible selon les froids calculs de Wall Street. Jamais ils n’auraient imaginé qu’un paysan, un homme d’origine indigène, un berger parmi les plus humbles, quelqu’un sans une grande machinerie médiatique derrière lui ni des sommes d’argent colossales, réussirait à leur disputer le pouvoir. Il n’avaient pas compté que ce personnage quelconque avait fabriqué tout en bas un outil qui représentait l’immense majorité du peuple bolivien.
Du fond des racines de la terre, du fond de la pauvreté la plus douloureuse, celle qui se dessine sur le visage et sur les mains des pauvres.
Cette pauvreté ancestrale qui a privé de leur éclat le regard des enfants boliviens. De jeunes garçons destinés au travail des champs, aux mines et à la mort. Des fillettes qui à 10 ans deviennent des vendeuses ambulantes ou des servantes.
Des petits enfants portés sur le dos de leur mère, tandis que celles-ci travaillent en vendant en ville ce que leurs familles récoltent. Des enfants habitués à travailler dès leur naissance. Des enfants sans berceuse ni berceau, avec pour seule chaleur celle de la couverture qui enveloppe le dos fatigué de leurs mères. Dès qu’ils naissent, ils apprennent à supporter le froid, la chaleur ou la pluie. Des garçonnets et des fillettes qui grandissent sans jouets, sans écoles, sans chansons, sans rires.
Dans les années 80, j’ai eu dans les mains un livre d’une femme bolivienne, épouse d’un mineur. Ce texte que nous lisions en cachette sous la dictature militaire argentine passa de mains en mains. Ce témoignage de Domitila Chungara demandait la permission de raconter au monde la vérité enfouie que vivaient les mineurs boliviens. « Si on me laisse parler » était terrifiant. Domitila racontait la vie des mineurs, la vie d’une famille où les hommes étaient vieux à 35 ans et où les femmes se couvraient de rides à 30. Des familles entières comme celle de Domitila qui s’entassaient dans des conditions de vie désastreuses dans des taudis tandis que leurs époux travaillaient dans les mines.
Elles devenaient veuves et leurs enfants n’avaient plus de père. Les mineurs mouraient à cause de l’étain dans le sang, de la tuberculose ou de l’éboulement d’une mine. Les enfants, d’une maladie quelconque, de celles qui se soignent ailleurs, ou de faim. Les femmes mouraient de misère ou en couches.
La victoire de Evo Morales est la victoire des exclus, des humiliés et des oubliés. C’est la victoire du peuple. L’esprit de Tupac Amarù [3] remporte à nouveau la victoire pour faire de cette Bolivie, tant aimé par le Libérateur [ Simon Bolivar, ndt] qui lui a donné son nom, le Potosì [4] mis à sac pendant quatre siècles d’extermination.
Des vents nouveaux parcourent notre Amérique. Le Che doit sourire en pensant à tous les combats qu’il va falloir livrer à partir de ce présent où l’ALBA se fraie un chemin parmi tant d’obscurité.
De nouveaux cours sont en fête et célèbrent ce triomphe de notre Amérique brune. Nos bras et nos voix sont prêts à les appuyer et à les défendre à l’aube de cette victoire pour que à nouveau nos enfants de Bolivie aient les yeux qui brillent et de la lumière dans leur sourire.
Salut, Président de Bolivie, Evo Morales, compagnon de la lutte contre l’ALCA, solidaire de toutes les batailles, que Tupac Amarù te bénisse et que Bolivar te protège de son épée.
Graciela Ramírez
Graciela Ramírez est née en Argentine. Elle vit actuellement à La Havane, où elle coordonne les actions du Comité de Libération pour les Cinq Héros Cubains, los Cinco de Miami.
[1] La nouvelle histoire de la Bolivie commence : Déclarations de Evo Morales après le résultat électoral. 18 décembre 2005. (Aporrea, Resumen Latinoamericano.)
[2] Le Tahuantisuyo : le nombril du monde, est le nom indien de l’empire inca dont la capitale était Cuzco.
[3] Tupac Amarù est un cacique indien qui mena l’une des plus célèbres révoltes contre les Espagnols. Il est resté le symbole de la lutte des Indiens pour la liberté.
[4] Le Potosì est une montagne de Bolivie qui produit d’énormes quantités de minerais, essentiellement de l’étain. Les conditions de travail y sont éprouvantes : chaleur intense, protections inexistantes ou dérisoires, matériel obsolète, horaires abusifs, etc… La ville de San Luis Potosì est bâtie au pied de la montagne. ( Lire : L’ancienne cité d’argent et l’enfer de ses mineurs par Irene Caselli Ndlr).
S’il vivait encore, Ernesto « Che » Guevara fumerait certainement un bon Havane à la santé d’Evo Morales ! Car ce que le plus célèbre des guérilleros n’a pu conquérir par les armes, un solide paysan aymara, qui fréquenta à peine l’école, l’a obtenu dimanche par les urnes. Et avec quel panache !
Malgré les pressions étasuniennes, des médias défavorables et les incessantes campagnes de dénigrement, Evo Morales a pratiquement obtenu la majorité absolue dès le premier tour. Quel que soit le décompte final, nul doute que le leader du Mouvement au socialisme (MAS) sera le premier indigène d’origine populaire à diriger un Etat américain. Trente-huit ans après la débandade des rebelles du « Che » dans la jungle de Santa Cruz, le rêve d’une nouvelle Bolivie est bien vivant.
Certes, comme nous l’écrivions samedi, le plus dur est à venir. Vingt ans de réformes néolibérales et cinq cents de colonialisme meurtrier ne s’effacent pas d’un coup de baguette magique. L’intégration des millions de laissés-pour-compte – paysans pauvres, mineurs exploités, travailleurs précaires – dans la nation bolivienne exigera de la patience et de l’obstination. Le programme du MAS est audacieux, encore faudra-t-il que l’Etat puisse rediriger les moyens financiers vers cette nouvelle économie solidaire et humaine qu’Evo Morales et son colistier Alvaro García Linera appellent de leurs voeux.
Une chose est certaine, même battus par les urnes, ceux qui accaparent aujourd’hui les richesses naturelles boliviennes ne laisseront pas filer leurs privilèges sans mot dire. Les curieuses manoeuvres, ce week-end, du Conseil électoral bolivien, qui a exclu du scrutin des milliers d’électeurs modestes sous des prétextes fumeux, préfigurent les entraves que certaines élites ne manqueront pas de mettre devant le gouvernement de M.Morales. D’autant que celui-ci semble avoir raté de justesse la majorité absolue à la Chambre haute du parlement. Quant aux multinationales, visées par les projets de nationalisation des hydrocarbures, elles tenteront par tous les moyens d’empêcher que la volonté populaire ne se fasse.
Mais foin de bémols ! Les raisons de se réjouir sont suffisamment rares pour ne pas partager, sans arrière-pensée, la joie qui depuis dimanche a envahi les quartiers défavorisés d’El Alto ou les plaines du Chapare. Parti de rien il y a dix ans, le mouvement social bolivien a démontré que rien n’est jamais impossible si on ne cède ni au découragement ni à l’intimidation. En ce sens, sa révolution pacifique est exemplaire.
Le contexte régional n’y est certainement pas étranger. Car avant les Boliviens, les électeurs brésiliens, vénézuéliens, panaméens ou uruguayens avaient déjà refusé que la politique de leur pays ne soit élaborée à la Maison Blanche ou à la bourse de Londres. Le virage latino-américain, aussi soudain qu’imprévisible, se confirme. Avec, en Bolivie, des accents anti-impérialistes encore plus marqués. Une leçon de souveraineté et de volontarisme politique dont feraient bien de s’inspirer nos molles social-démocraties européennes !
Il y a quarante ans, le « Che » exhortait les peuples à « créer un, deux, trois, plusieurs Vietnam ». On a envie de le paraphraser : « Une, deux, trois Bolivie !
Benito Perez
Source Le Courrier de Genève www.lecourrier.ch
La déferlante Evo Morales
Par Nadine Crausaz, Bolivie, mardi 20 décembre 2005.
Evo Morales Ayma, candidat du Mouvement au socialisme, nous expose les mesures qu’il prendra, s’il est élu président.
L’ Humanité, 17 décembre 2005.
Les sondages prévoient que vous pouvez être élu, mais sans obtenir la majorité au Parlement ni dans les préfectures. Quelles alliances envisagez-vous ?
Evo Morales. Premièrement je ne crois pas aux sondages. En 1997, quand le MAS est apparu pour la première fois, on lui accordait 1 % ; or nous avons atteint 3,8 % ; en 2002, on nous créditait de 6 à 8 % et nous avons obtenu 21 %. Aujourd’hui, on nous crédite de 35 %. Je crois que nous réservons une grande surprise. Pour en finir avec les accords de palais, les manoeuvres, nous devons gagner avec plus de 50 %. Le mensonge, le secret ne font pas partie de notre culture. Le vote du peuple ne se négocie pas. Et il n’y a rien à négocier avant le 18 décembre. Que ceux qui partagent nos idées et veulent se joindre à nous, viennent ; ils sont les bienvenus.
La question de la nationalisation des hydrocarbures est devenue une question politique majeure. Que ferez-vous en cas de victoire ?
Evo Morales. Cette idée a surgi du peuple même. La Bolivie est depuis cinq cents ans pillée de ses richesses. La terre, notre Pacha Mama, est généreuse : la Bolivie, malgré le pillage, est encore riche et les ressources appartiennent au peuple qui doit pouvoir exercer son droit de propriété. Nous annulerons les lois qui ont livré les hydrocarbures aux multinationales, car elles sont illégales, n’ayant pas été approuvées par le Parlement. Ces lois stipulent que le gaz cesse d’être bolivien lorsqu’il arrive à la bouche du puits ; les groupes qui l’exploitent peuvent en jouir à leur gré. Cela va cesser. Nous avons besoin d’investissements, aussi redéfinirons-nous les contrats avec des partenaires, non plus des propriétaires. En matière économique nous prônons la diversité de l’entreprise. Et nous devons industrialiser les ressources naturelles pour soutenir le développement.
Que ferez-vous si les firmes étrangères en appellent aux tribunaux internationaux ?
Evo Morales. Ces entreprises ont pillé, n’ont pas payé leurs impôts, ne se sont pas préoccupées du peuple, ni du pays. Quelle légalité, quelle autorité morale possèdent-elles ?
Dans la presse, votre nom apparaît accompagné de qualificatifs comme : « narco-dirigeant » voire « narco-trafiquant ». En quoi cela vous affecte-t-il ?
Evo Morales. Cela fait partie de la guerre sale que me livre par exemple Tuto Quiroga, avec lequel j’ai refusé de débattre tant qu’il ne retirerait pas ses insultes d’« assassin » de « narco-traficant ». Durant sa courte présidence, il a fait assassiner nos camarades cocaleros du Chapare. Concernant la culture de la coca, je suis fier de dire que nous devons à la coca nos luttes pour la terre, la dignité, l’existence du MAS qui est un instrument politique pour le peuple. Quant au narcotrafic, que brandissent les États-Unis, prétexte pour prendre pied en Bolivie, nous remarquons que des millions de dollars qu’il génère pas un dollar ne va dans la poche du cultivateur, mais dans celle des politiciens corrompus. Nous sommes entièrement d’accord pour une lutte effective contre le narcotrafic.
Quelles sont et seront vos relations avec vos voisins, certains vous reprochant vos amitiés avec Fidel Castro et Hugo Chávez ?
Evo Morales. À Cuba, comme au Venezuela, les services sociaux de base sont à la charge de l’État. Toute privatisation de ces services est un viol aux droits des citoyens. Comme le bradage des ressources naturelles. Je pense que nous devons renforcer le Mercosur et toute forme de coopération. Dans ce cadre, nous discuterons avec Lula pour que Petrobras rende les raffineries de Santa Cruz qui lui ont été livrées. Dans le cadre d’une unité sud-américaine, nous pourrons fixer le prix des matières premières. Nous devons partager les expériences de luttes des différents peuples et apprendre de chacun. Je pense également que nous devons aller vers une monnaie commune. Tout cela dans le respect de la composante indigène du continent, véritable propriétaire de la terre.
Comment pensez-vous régler l’antagonisme entre les populations indigènes, majoritairement situées dans l’Altiplano, les hauts plateaux occidentaux et la population blanche de la zone orientale ?
Evo Morales. Cet antagonisme supposé est aiguisé par ceux qui veulent, sous couvert d’autonomie, préserver leurs privilèges. Gaz, pétrole et autres ressources appartiennent au peuple et doivent participer au développement de tous. Nous sommes différents sur le plan physique et économique, mais nos cultures indigènes n’excluent pas mais fédèrent tout au contraire. Notre culture est de réciprocité et de solidarité. Quand nous serons élus, il n’y aura aucune vengeance ou mesquinerie de notre part. Le peuple décidera, c’est pourquoi nous avons proposé la convocation d’une assemblée constituante pour une réforme constitutionnelle.
Entretien réalisé par Gérard Devienne
La misère de l’Altiplano. Bolivie.
Ce pays, le plus pauvre d’Amérique du Sud, vote ce dimanche pour la présidentielle et les législatives. Evo Morales, indien, pourrait être élu.
Rues et places de La Paz, d’El Alto, sont un immense marché « indigène, pittoresque, haut en couleur et costumes traditionnels », comme disent les guides touristiques. Ils sont un million et demi dans l’ensemble du pays à occuper leur modeste poste de vente, proposant tout et n’importe quoi.
Quel choix aura été le leur ? Visage et mains polis par le soleil tropical et les vents pauvres en oxygène, Julio Patiño, secrétaire de la Fédération des « gremiales » de La Paz, qui regroupe 50 000 vendeurs et artisans, tranche : « La misère : la majorité sont des paysans de l’Altiplano, les hauts plateaux, chassés par la faim et l’existence implacable du latifundia qui les prive de la terre ; d’autres sont des mineurs et des ouvriers licenciés. » « Être gremial, précise-t-il, offre la dernière possibilité de ne pas sombrer dans la délinquance, la prostitution, le crime. » Si en Occident, commerce est synonyme de prospérité, en Bolivie, il n’en est rien. « Notre poste de vente, continue Julio Patiño, nous permet tout juste de nourrir la famille, et nous devons nous battre contre les augmentations d’impôts. » Les gremiales ont rejoint les grandes luttes sociales depuis 2003, aux côtés de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) dont ils se sentent proches, tout en menant leurs luttes propres. « Devant l’absence de réponse des pouvoirs publics, nous envisageons une mesure extrême, conclut le secrétaire d’un des quatre syndicats de gremiales : la grève de la faim massive. »
Marisol Mamani, dans ses atours traditionnels, jupons de couleur superposés, chapeau de feutre incliné sur le côté, propose des « spécialités culinaires » à El Alto. Elle décrit sa ville, elle qui naquit à la campagne, « El Alto qui n’existait pas il y a trente ans et qui comptera bientôt autant d’habitants que La Paz ». Les grandes révoltes populaires de 2003 ont éclaté ici. « Nous avons payé le plus lourd tribut à la répression. L’armée a tiré au canon : 59 des 83 compagnons assassinés étaient d’El Alto », se souvient-elle. « Le coeur du mouvement populaire se trouve ici, dans les « juntas vecinales », les associations d’habitants, précise-t-elle. La ville est jeune et ses habitants sont jeunes en majorité. Ils poursuivent les luttes de leurs pères mineurs ou paysans, avec en plus ce sentiment d’immense injustice. Eux ne se laissent pas tromper par les beaux discours et, en plus, ils sont davantage ouverts », conclut-elle.
Dans un des sièges des juntas (la ville est divisée en sept secteurs), les conversations s’alimentent du thème des élections. Certains voteront pour Evo, quelques autres pour Felipe (Quispe), un parle de s’abstenir. Tous sont unanimes pour affirmer « que quel que soit le président, s’il ne réalise pas le souhait du peuple, en premier lieu la nationalisation des hydrocarbures et l’expropriation des multinationales, il devra affronter la colère du peuple ». « Nous avons acquis une formidable expérience de lutte, sourit un jeune. Nous savons creuser des tranchées pour empêcher les chars de passer, nous savons organiser la répartition de vivres et d’informations, et depuis El Alto nous dominons La Paz et contrôlons les routes et l’aéroport. » Son voisin, jeune comme lui (ils doivent avoir moins de vingt ans), ajoute : « J’ai une confiance limitée en Evo ; il peut faire le coup de Gutierrez en Équateur ou du Cholo [le métis] Toledo au Pérou : se faire élire par les indigènes et ensuite gouverner pour les Blancs riches. » « Nous devons voter pour lui, reprend une mère de famille, il n’y a pas d’alternative, mais ensuite nous devrons maintenir la pression sur son gouvernement, vu que les Yankees vont y mettre la patte. »
Dix jours avant les élections un « sommet » a réuni à El Alto, les juntas, la COB, le Parti communiste, le mouvement indigène Pachakutik de Felipe Quispe et des dizaines d’organisations sociales et paysannes. Carlos Carvajal Nava du PCB énumère les limites et objectifs du sommet. « Le mouvement originel a évolué, d’une vision indigène, quasi raciste, vers une conscience nationale, comme le démontre le thème du gaz, analyse le dirigeant communiste. Les affrontements au sein des partis et de la COB, affaiblissent le mouvement. Mais la gauche reste forte en Bolivie. Il convient de donner à cette force une base idéologique et une direction politique », conclut-il.
Dans les rues de La Paz et El Alto, les affiches des candidats rappeleant l’importance d’un scrutin que l’on peut qualifier d’historique, sans crainte de galvauder le vocable
Gérard Devienne, correspondance particulière
Tous les articles
* Bolivie > Bolivie, Notre Victoire, par Graciela (…)
* Bolivie > Une, deux, trois Bolivie… La déferlante Evo (…
* Bolivie > Elections en Bolivie : « Le peuple (…)
* Bolivie > Elections 18 décembre : Evo Morales peut-il (…)
* Bolivie > Bolivie, élections du 18 décembre : entre (…)
* Bolivie > Bolivie, 18 décembre : Evo Morales premier (…)
* Amériques > Interview d’un compagnon du Che : (…)
* Livre sur les Cinq prisonniers cubains : (…)
* Cinq agents cubains emprisonnés : lettre (…)* Réponse aux mensonges de Reporters sans (…)
> Bolivie
Elections 18 décembre : Evo Morales peut-il changer la Bolivie ? par Benito Perez.
17 décembre 2005
Le leader du Mouvement au socialisme est aux portes de la présidence. Figure de proue d’un mouvement social qui a jeté deux présidents en deux ans, le paysan aymara parviendra-t-il à faire de la Bolivie une République pour tous ?
Le Courrier, samedi 17 décembre 2005.
Ce week-end, l’Amérique latine a les yeux braqués sur la Bolivie. Plus précisément sur un petit homme trapu, paysan aymara devenu leader social, en passe de remporter le premier tour d’une élection présidentielle déjà qualifiée d’historique. Evo Morales, puisque c’est de lui qu’il s’agit, agrégerait plus d’un tiers des intentions de vote, selon les sondeurs, 5-6 points de mieux que son principal adversaire de droite Jorge « Tuto » Quiroga. Un écart à mettre au conditionnel, puisque depuis l’irruption du Mouvement au socialisme (MAS) dans l’arène politique bolivienne en 1997, les sondages l’ont systématiquement sous-estimé. Autant dire que la victoire du leader indigène lors de ce scrutin est attendue… pour autant qu’aucune fraude ne vienne lui faire barrage !
Dans cette immense République dirigée depuis l’origine par l’infime minorité blanche ; dans un pays recouvrant les deuxièmes réserves latino-américaines de gaz naturel et où plus de la moitié des habitants n’ont pas accès à l’électricité, la montée en puissance de la gauche indigène et de son charismatique leader est un événement en soi. Aymara des haut-plateaux andins grandi parmi les Quechuas et les petits Blancs du Chaparé tropical, né à la lutte sociale parmi les paysans cocaleros, « Evo » symbolise l’espoir de tous les laissés-pour-compte du pays.
Et ils sont nombreux ! Vingt ans de dictatures, autant de réformes néolibérales ont creusé les inégalités. Deux tiers des Boliviens vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Ils habitent la campagne ou les banlieues des grandes villes, principalement dans l’ouest du pays. L’immense majorité est d’origine amérindienne. Ce sont eux qui ont chassé les présidents Gonzalo Sanchez de Lozada en octobre 2003 et Carlos Mesa en juin dernier. Au grand dam des 20% de Boliviens qui se partagent la moitié du revenu national, regroupés, eux, au coeur de La Paz et dans les provinces de l’ouest. Face à cet abîme, le discours sans ambages d’Evo Morales, empreint de nationalisme de valeurs amérindiennes, rassemble aussi largement que ses tee-shirts du Che et ses déclarations à l’emporte-pièce effraient.
Radical et pragmatique, aussi têtu qu’à l’écoute des masses, Evo Morales a su capitaliser sur le ressentiment de nombreux Boliviens à l’égard de l’ingérence étasunienne et le discrédit pesant sur les partis traditionnels. Au point que son adversaire, l’ex-président « Tuto » Quiroga, a dû s’inventer un nouveau parti « Podemos » (Nous pouvons) pour faire oublier son appartenance à l’Action démocratique de l’ex-dictateur Hugo Banzer.
Arrivé deuxième de la présidentielle de 2002 avec 21% des suffrages, Evo Morales est assez fin stratège pour savoir que l’élection du 18 décembre – aussi prometteuse soit-elle – n’est qu’une étape vers cette nouvelle Bolivie qu’il appelle de ses voeux. Plan de route.
DEVENIR PRÉSIDENT
Pour devenir, en janvier 2006, le président de tous les Boliviens, le candidat de la gauche devra obtenir le soutien au moins tacite d’une partie de ses concurrents. En Bolivie, le second tour se joue en effet au parlement, arène que tous les sondages donnent acquise à ses adversaires. M. Morales, qui se refuse à tout marchandage avec la classe politique traditionnelle, ne pourrait alors compter que sur la pression populaire et la légitimité de son avance sur son éventuel second. Troisième des sondages avec moins de 10%, l’entrepreneur centriste Samuel Doria Medina a déjà assuré Evo Morales de son soutien s’il venait à remporter le scrutin avec 5 points d’avance.
Plus surprenant, le commandant en chef de l’armée a appelé cette semaine les futurs députés à élire le vainqueur du premier tour ! Plus que tout autre, l’amiral Marco Antonio Justiniano sait qu’un résultat contraire pourrait déboucher sur une grave crise sociale. En tout cas, plus d’un Bolivien sur deux pronostique qu’Evo sera leur prochain chef de l’Etat.
GOUVERNER
Face à un parlement présumé hostile et aux velléités sécessionnistes des riches provinces de Santa Cruz et de Tarijá, la tâche d’un éventuel gouvernement du MAS ne sera pas aisée. Un Morales président ne pourrait exercer réellement le pouvoir que s’il dispose d’une forte mobilisation de ses électeurs. Or le soutien des organisations de base ne lui est pas automatiquement acquis. Syndicats et associations boliviens sont bien moins homogènes qu’on ne l’imagine en Europe. La direction de la Centrale ouvrière (COB), dont les troupes se recrutent surtout chez les mineurs, et le Mouvement indigène Pachakuti, de l’Aymara Felipe Quispe, se montrent très réticents face à l’hégémonie du MAS sur les masses.
A des degrés divers, les autres acteurs du mouvement social – telle la fameuse Coordinadora del Agua de Cochabamba – se disent toutefois prêts, dans un premier temps, à faire bloc derrière un gouvernement du MAS. En ce sens, l’apparition du sociologue et ex-guérillero Alvaro García Linera sur le ticket présidentiel d’Evo Morales a permis un rapprochement des cercles progressistes urbains avec la base paysanne du MAS.
Autre atout maître en mains du candidat aymara : la future Assemblée constituante, dont le principe a été largement accepté lors de la crise de juin dernier. A l’instar d’Hugo Chávez lors de son premier mandat à la tête du Venezuela, Evo Morales espère y puiser la légitimité pour transformer en profondeur les institutions. Une « Révolution politique » ou « décolonisation de l’Etat », selon les termes de García Linera, le candidat à la vice-présidence [1]
QUELLE POLITIQUE ?
Malgré son nom, le MAS d’Evo Morales ne rêve pas, à court terme, de société sans classes. « On ne construit pas le socialisme sans prolétariat », tranche M. Linera. Son modèle se veut pragmatique. Premier objectif : nationaliser les hydrocarbures comme l’on exigé les citoyens l’an dernier par référendum. Avec les immenses profits escomptés – les exportations de gaz représentent 10% du PIB bolivien – l’Etat renforcé devra « articuler » les trois types de production coexistant en Bolivie, à savoir les économies communautaire, familiale et industrielle. Un équilibre en mouvement, que le sociologue appelle « capitalisme andin-amazonique ».
Parmi les projets concrets, on note la création d’une banque des technologies, d’un système national de droits de propriété intellectuelle collective, le développement du micro crédit, une loi de promotion des PME et des coopératives, un plan de lutte contre la spéculation foncière et la titularisation des terres communautaires. Un Défenseur agraire serait également nommé.
Au niveau social, le ticket Morales-Linera propose l’instauration d’un système de sécurité sociale sanitaire, la légalisation et l’assainissement des quartiers périurbains (bidonvilles) et une réforme scolaire garantissant la gratuité, l’égalité de genre et la pluriculturalité.
Financièrement, le MAS mise sur la hausse des revenus des hydrocarbures et une fiscalité progressive, mais également sur un Etat frugal dans son fonctionnement.
DIFFICULTÉS
Le défi que s’est fixé le MAS est-il disproportionné ? Déjà lourdement endettée, une Bolivie dirigée par Evo Morales perdrait les millions versés chaque année par Washington ainsi que son appui auprès des institutions financières. La volonté de contrôler les ressources naturelles heurtera de plein fouet les multinationales. On peut compter sur Repsol, British Gas ou Exxon pour multiplier les procès que des systèmes internationaux de « protection » des investissements leur permettront de gagner. Les précédents de l’eau à Cochabamba et à El Alto font figure de mises en bouche. Autre question en suspend : où l’Etat trouvera les fonds pour développer les infrastructures gazières ?
Comme au Venezuela, la gauche pourrait aussi être victime de la fronde des élites économiques et technocratiques, promptes à saboter un gouvernement défavorable à leurs intérêts. A contrario, le mouvement social possède-t-il les cadres nécessaires pour bâtir un tel projet ?
Enfin, demeure l’hypothèque du séparatisme des riches provinces orientales. Après avoir profité durant des décennies des bénéfices miniers pour développer leur région, les élites de Santa Cruz et Tarija ne veulent plus entendre parler de solidarité nationale. Malgré un appui croissant à Evo Morales, notamment chez les indigènes guaranis, les plaines de l’Est font figure de refuge pour une bourgeoisie hostile aux appétits de La Paz.
ATOUTS
Malgré ces bémols, la perspective d’un changement en profondeur de la Bolivie ne doit pas être sous-estimée. Quel que soit le résultat des urnes, le courant progressiste politiquement incarné par Evo Morales ne s’estompera pas. Fortement structuré, pacifique malgré la répression, s’appuyant sur une base aussi lucide politiquement que parfois incontrôlable, le mouvement social bolivien n’a pas jeté les transnationales Bechtel de Cochabamba et Suez d’El Alto ainsi que deux présidents en moins de cinq ans par hasard !
Sa prochaine conquête – une vraie Assemblée constituante – pourrait être décisive.
D’autant qu’une Bolivie rompant avec le modèle néolibéral disposerait d’atouts non négligeables sur le plan international. Lula et Chávez ne cachent pas leur sympathie pour le MAS. Le Brésil – qui importe bonne part du gaz bolivien – et le Venezuela seraient des partenaires de choix pour développer ce secteur.
Plus cocasse encore, la soif d’hydrocarbures des économies capitalistes occidentales et leur volonté de maintenir des prix raisonnables devraient les amener à composer avec M. Morales. Un boycott du type de celui subi par Cuba est peu probable. L’exemple vénézuélien en témoigne. L’or noir fait souvent perdre la boussole idéologique.
Benito Perez
« Tout dépendra de la pression populaire
Fondateur du fameux périodique « El Juguete Rabioso »[1], Sergio Cáceres réside en France. Cela n’empêche pas le journaliste et écrivain bolivien d’attendre avec fébrilité le verdict des urnes.
Le Courrier : Vous êtes en contact régulier avec la Bolivie. Comment est l’ambiance à quelques jours du scrutin
Sergio Cáceres : Il y a un grand enthousiasme pour la possible victoire du MAS. Même ici en Europe, nombre de Boliviens soutiennent activement le MAS
Vous pensez qu’Evo Morales sera élu ?
- En Bolivie, on donne sa victoire pour acquise. Il se maintient depuis des semaines en tête des sondages. C’est en effet le plus probable.
Le MAS n’aura probablement pas de majorité au parlement. Avec qui gouvernera-t-il ? Que fera l’opposition ?
- Il y a fort à parier que l’opposition tentera de bloquer et d’asphyxier le gouvernement. Pour le MAS, tout dépendra des pressions populaires et de ses résultats obtenus. N’oublions pas que son gouvernement comptera une majorité de leaders sociaux.
Que pensez-vous du programme du MAS et de son « capitalisme andin-amazonique » ?
- Au-delà de son nom, le projet de García Linera est le programme économique le plus intéressant et novateur proposé aujourd’hui. C’est une réflexion qui part de la réalité de la Bolivie et non pas, comme c’est le cas pour les autres partis, une recette concoctée aux Etats-Unis.
Le MAS est un parti paysan. La gauche bolivienne compte-t-elle assez de cadres en mesure de mener un gouvernement populaire ?
- Soyons réalistes : c’est une des faiblesses importantes du MAS. Ce mouvement est encore en phase de consolidation. Il court contre la montre. Espérons qu’il aura la capacité d’improviser sans que ses contradictions internes ne l’étouffent. Mais attention : le MAS n’est pas un parti paysan. C’est une coalition de mouvements sociaux parmi lesquels on trouve des mouvements indigènes, des associations d’habitants, des syndicats, des coopératives et des fédérations paysannes.
Pensez-vous qu’une nationalisation des hydrocarbures soit possible ?
- Je ne suis pas un spécialiste du domaine. Mais il faut rappeler que ce pays les a déjà nationalisés par deux fois (en 1937 et 1969, ndlr).
Y a-t-il des risques de sécession de Santa Cruz et Tarijá ?
- Non. Si les revendications autonomistes me semblent valables, les menaces de guerre civile ou de sécession ne sont rien d’autre qu’un rideau de fumée visant à déstabiliser le pays.
La Bolivie peut-elle devenir un nouveau Venezuela ?
- Ce que l’on espère c’est qu’elle devienne une nouvelle Bolivie !
Benito Pere
Source : Le Courrier de Genève www.lecourrier.ch
La plaque dit « mausolée », mais c’est la seule chose un peu plus haute qu’une tombe dans tout le cimetière de Tarapacà, le ciel bas des Andes est un couvercle de bleu, le diacre avec sa guitare chante pour un groupe de cholas qui pleurent. « Justicia, cajaro » -justice, merde- et la chanson se termine, le prêtre commence à bénir enfants et femmes aux petits chapeaux melon et polera, le vêtement traditionnel des femmes andines. Ce sont les veuves et les orphelins de la guerre du gaz. Il y a deux ans exactement, coincé entre la rue enflammée de colère et des contrats lucratifs de fourniture à honorer, le président Gonzalo Sanchez de Lozada ordonnait à l’armée de sortir des casernes et de ramener l’ordre. Il fit un massacre, quatre vingt morts au moins et des centaines de blessés, puis prit la fuite. Dans toute la Bolivie, partout où il y a un nom à commémorer, il se passe ces jours ci la même chose. Honneur à nos morts, procès au « Gringo » De Lozada.
« Ils sont morts, un samedi, c’était un jour comme aujourd’hui » : Nestor, Salinas, ils ont tué son frère et, pendant des heures, la troupe a séquestré même sa dépouille, jusqu’à ce que les gens aillent la reprendre de force, il s’appelait David, c’était le plus jeune et aujourd’hui Nestor est président du comité des victimes. Carlos marche avec des béquilles, il a perdu une jambe : c’est une rafale de mitraillette qui la lui a arrachée, ce jour là même les tanks faisaient feu. Sa jambe aussi est ensevelie à Tarapacà. Alex Llusco Mollericona avait cinq ans et maintenant c’est une petite boîte blanche et une photo sur un poster, un projectile est entré dans sa bouche et ressorti par la nuque. Il dort sur la colline comme tous les morts de la guerre du gaz, une de ces collines à quatre mille mètres dans les Andes, dont la Bolivie a découvert récemment la furie, terre des indigènes aymara, très pauvres et furibonds, qui ont chassé les deux derniers présidents de Palacio Quemado – palais brûlé, parce qu’on l’a déjà rôti deux fois dans l’histoire. Maintenant ils veulent mettre la main sur leur première victime, l’assassin, le « Goni » De Lozada. Et ils se le jurent mutuellement, en allumant une autre bougie. Comme une insulte urbanistique, le cimetière de Tarapacà voisine avec une grande caserne de la cavalerie. C’est de là que sortirent les massacreurs.
C’était un automne très chaud de la Bolivie, en 2003 ; des manifs une après l’autre. L’été, De Lozada avait fait savoir que le gaz bolivien de Tarija irait finir au Chili, par l’intermédiaire du consortium Pacific Lng. Et il avait eu tort : en quelques semaines, le pays s’était enflammé pour défendre ses hydrocarbures, en manifestant avec beaucoup de bruit, en demandant ouvertement sa démission, en arrêtant les camions citernes pleins d’essence que le gouvernement avait envoyé réapprovisionner les dépôts de La Paz mis à sec par des semaines de blocus des routes, en empêchant aussi le retour des touristes du lac Titicaca (une centaine restèrent bloqués). Le 11 octobre 2003, « Goni », c’est le surnom qu’il avait pris pour sa campagne électorale, pour essayer d’être populaire malgré son accent américain, décida qu’il en avait assez et donna l’ordre à l’armée de sortir des casernes. Les troupes d’élite du Quatrième de Cavalerie Ingavi, basées à El Alto, prirent l’avenue Juan Pablo II (exactement : avec une atroce croix en ciment au milieu, la seule chose que le pape ait apporté dans son voyage dans les Andes) et la transformèrent en cimetière. Ils sortirent et ils tuèrent le premier jour, ils sortirent et ils tuèrent le deuxième. Le troisième jour, les soldats firent savoir qu’ils ne bougeraient plus, presque tous venaient de la montagne et ils en avaient assez de tirer sur parents et amis. Colonels et généraux comprirent, pour le président De Lozada c’était le début de la fin.
Doña Juana Valencia pleure contre un étendard de la mairie. « Mon mari est ici, tué par une balle, il s’appelait Marcelo Carabezal Loren, je suis seule avec six enfants ». Le cimetière de Villa Ingenio est sous ce même ciel qui a l’air d’un plafond, à quelques collines de distance du centre de El Alto, au large de la terre qu’ils appellent Andes, juste à côté d’une décharge imposante et fétide dont le vent se charge largement de faire la publicité. Patricia Amalia Luna pleure son mari, « il s’appelait Damian Palacios », un autre nom sur un autre mausolée qui surplombe d’un mètre un chaos de tombes éparpillées au hasard par un croque-mort hystérique – la concession funéraire dure quelques années, après, ou on la renouvelle ou bien le mort change de maison et les « collas », les pauvres des montagnes, ont peu d’argent, en général ils s’en servent plus pour les vivants que pour les défunts. Olga Quelque pleure son fils Luis Fernando, et son mari « mort de chagrin », dit-elle, quelques jours plus tard. Don Modesto Chino célèbre une messe brève, l’avocat Rogelio Mayta reconnaît : « Ces assassins, nous n’arrivons pas à les juger parce qu’ils sont riches ». Sur la plaque, il y a écrit : « Héros de la guerre du gaz », et il y a 22 noms. Luis avait 16 ans, célibataire, mort par balle. Florentino, Benita et Dominga, morts de brûlures à des dates diverses. Roxana, 19 ans, par balle…
Le 13 octobre, dans La Paz prête à rejoindre la protestation et 20 mille manifestants à s’affronter avec l’armée dans la rue, le vice-président Carlos Mesa retire son appui au gouvernement, « pour des raisons de conscience ». Dans les morgues et les églises maintenues ouvertes par des curés indignés, il y a déjà 63 morts, les gens vont chercher les corps par la force, en défiant les fusillades. Les paysans aymara abattent à la corde les ponts pour les piétons, en ciment armé, d’où l’armée tire ; aux médecins qui crient qu’ils ont trop de blessés à soigner ils répondent « soignez-les bien sinon on détruit aussi l’hôpital », et, à la force des bras, ils jettent aussi à terre dans la rue quelque wagon de chemin de fer (quand tout fut fini, la grue qui devait libérer la rue se rompit en essayant de déplacer les wagons). Les Etats-Unis, l’Organisation des états américains, la Cofindustria et une poignée d’autres sigles nationaux et internationaux apportèrent leur appui à Sanchez De Lozada, qui, le 15 octobre essaya de freiner la fuite du gaz qui brûlait le pays, évoquant la possibilité d’un référendum mais sans donner de date, et en accusant les chefs de la rue de chercher « une dictature narco-syndicaliste ». Les mouvements de rue redoublèrent de fureur, en quelques jours le gouvernement perdit presque tous ses pions. Le 17 octobre De Lozada annonça qu’il allait démissionner dans un discours à la télé. Il fit au contraire ses bagages, embarqua sa femme Ximena, sa fille Alexandra, son ministre de la défense (Carlos Sanchez Berzain, dit le Zorro, le renard) et celui des hydrocarbures Jorge Berindoargue, berna le service d’ordre mis en place par le leader indigène Evo Morales tout autour de Palacio Quemado et s’enfuit en hélicoptère de l’Académie militaire de La Paz pour l’aéroport de El Alto et de là, dans la fidèle Santa Cruz, chez les « cambas », les riches de la plaine, aux pulsions sécessionnistes ; puis, aux Etats-Unis. A la tombée de la nuit, toute la bande était déjà à Miami.
La musique est à mi-chemin entre la fanfare de paroisse et les Inti Illimani, des pétards de proportion gigantesque pétaradent, une cohorte de ponchos avance sur la route et dépasse les restes d’un poste de police qu’on a fait sauter. Achacachi est la municipalité rebelle des aymaras boliviens, un endroit sans la moindre trace d’autorité publique qui ne soit communautaire, c’est-à-dire nommée en assemblée et révocable à tout moment. Pas de préfet, pas de soldats, pas de policiers, aucun receveur. Les premiers morts du gaz sont arrivés ici, en septembre, quand l’armée bolivienne a essayé de dégager des blocus routiers pour les touristes qui étaient bloqués sur le lacTiticaca. Quatre aymara et un soldat moururent dans un affrontement armé à Warisata, le siège de la première extraordinaire université indienne du pays, foyer de contestation et de mouvements. Le leader indigène Felipe Quispe, le Maliku (chef), accusa le gouvernement et se déclara prêt à ouvrir le feu, De Lozada accusa les universitaires, d’autres régions se soulevèrent, la Central obrera déclara la grève générale illimitée et, comme première revendication , la démission de De Lozada. C’était l’étincelle qui allait faire exploser le pays et Achacachi le commémore par un événement historique à sa manière : en recevant une caravane internationale de solidarité. Des blancs, qui depuis quelques temps ne sont plus admis dans la zone. La caravane Mayaki (en aymara « nous sommes un seul ») vient d’Italie, elle est composée de militants politiques, sympathisants, délégués de parti comme Italo Di Sabato, du Prc, de journalistes et même d’une institution : la mairie de Rome, avec la vice-présidente du conseil municipal Monica Cirinnà, et un conseiller, Nunzio D’Erme. C’est une cérémonie longue et élaborée, d’abord sur une colline brûlante de soleil, puis au siège occupé par la mairie. Le « maire » d’Achacachi, Eugenio Rojas, remet au représentant de Rome une demande formelle d’aide : aidez-nous à extrader et juger Gonzalo Sanchez De Lozada, le Goni, l’assassin.
De Miami, De Lozada se faisait interviewer en accusant : narco syndicalistes, terroristes, et en s’en prenant même à la déloyauté de son vice président Mesa (qui ne durera pas, il sera contraint à son tour de démissionner). Des capitaux énormes, des bureaux à Washington, des protections à la cour pétrolière des Rockefeller, le « Gringo » De Lozada semblait être parfaitement à son aise au nord du Rio Bravo. Mais avec la rue bolivienne encore en feu, le chef du Mas, principal parti d’opposition, l’aymara Evo Morales, demande au parlement l’inculpation formelle du président en fuite. Le 22 octobre un juge ouvre la procédure de vérification de l’inculpation de Sanchez De Lozada, mais c’est un an plus tard seulement, en novembre 2004, qu’une plainte de l’association des familles des victimes de la guerre du gaz arrive à faire démarrer le procès. Le 22 juin, le département d’état étasunien a reçu une requête formelle d’inculpation pour l’ex-président et ses deux ministres en fuite, les derniers d’une longue série d’assassins qui ont trouvé refuge au pays du dollar et de la « guerre au terrorisme ». Détail savoureux : De Lozada aurait un visa comme accompagnateur de sa femme, une dame d’âge mûr de la meilleur société bolivienne, qui elle, a un visa d’étudiante. Autre détail savoureux : selon certaines interprétations, la réforme récente du code pénal empêcherait le jugement par contumace. Le père de la réforme a été, oui, faisant preuve d’une grande clairvoyance, Sanchez De Lozada.
Aux requêtes boliviennes, le ministère de Condoleeza Rice n’a même pas répondu, naturellement, pendant que l’ambassadeur en Bolivie David Greenlee continue à s’allier avec les principaux représentants du pouvoir d’état bolivien pour gérer l’épisode complexe des élections de décembre (dans les sondages, Evo Morales est nettement en tête, une argutie constitutionnelle pourrait aussi bloquer le vote et ce serait d’autres rues en flammes, d’autres mouvements). Et les aymaras boliviens, du milieu du rien au sommet des Andes, sont en train de lancer ce qui est une vraie campagne internationale pour l’extradition de Gonzalo Sanchez De Lozada et de ses complices. Justicia, carajo.
Roberto Zanini, envoyé à La Paz, co-rédacteur en chef. d’il manifesto.
Source : il manifesto www.ilmanifesto.it
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizi
Para Nidia, muy paz
Une nouvelle vague révolutionnaire traverse la Bolivie, par Jorge Martin.
5 juin 2005